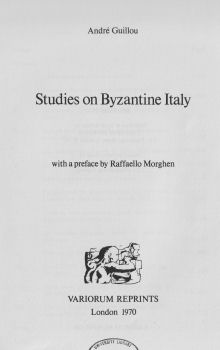I. - Annales
80
a) Les origines: VIIe-VIIIe
siècles
81
b) Naissances et renaissances: IXe-XIIe
siècle
83
c) Extinction: XIIIe-XVe
siècle
87
II. - Le fait monastique dans l’économie et
dans la société
88
A) Βίος πρακτικός, ou monachisme grec et
économie en Italie du Sud et en Sicile
88
B) Βίος θεωρητικός, ou société monastique
et spiritualité grecques en Italie du Sud et en Sicile
97
1) Introduction
Images de couvents
—
Portraits de moines
2) L’idéal du moine grec: cénobitisme
et hésychasme 104
«Κοινωνία γὰρ βίος τελεωτάτη ..., κοινὰ δὲ τὰ
σύμπαντα ...
—
Ἐρημία καὶ ἡσυχία: solitude et paix contemplatives
Conclusion
110
L’Italie méridionale et la Sicile médiévales sont de ces régions privilégiées
pour l’historien de la civilisation, où se rencontrent, s’affrontent et
cohabitent des populations de races diverses, et sous des régimes politiques
successifs; ce sont ici les Latins, les Arabes et les Grecs. Mais qui dit
cohabitation dit points de contacts et de cohérence et points d’opposition et de
séparation; saisir et expliquer ceux-ci, déterminer la part de chacun dans la
vie de l’ensemble constitue une tâche passionnante, mais combien délicate. C’est
ainsi que l’histoire politique de l’Italie sous le régime byzantin du VIe
au VIIIe siècle pour l’Italie de l’Exarchat de Ravenne, et du IXe
au milieu du XIe siècle pour le Sud, raconte l’histoire du régime
byzantin appliqué à ces régions, mais nous laisse ignorer l’histoire des
Byzantins et des Grecs d’Italie qui s’étend bien au-delà du rembarquement des
troupes byzantines à Bari en 1071. Les historiens de l’art sont venus, certes,
colorer et animer ces descriptions et ces récits; il n’en reste pas moins que,
profitant des tendances de l’histoire moderne, il nous faut repenser ces images
dans le cadre d’une histoire de la civilisation grecque; maints faits humains,
en outre, qui sont documentés ici, ne le sont pas dans les terres demeurées plus
longtemps byzantines et sont restées là indéchiffrables. C’est donc à des
enquêtes successives que l’historien doit se livrer, mais, en faisant halte de
loin en loin pour
*. Une première rédaction de ces quelques pages a été
présentée en langue italienne sous forme de rapport à la deuxième semaine
d’études organisée par l’institut d’Histoire Médiévale de l’Université
Catholique de Milan à Passo della Mendola (Trento) en septembre 1962 sur le
thème: «L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e ΧIΙ».

80
faire le point et retoucher le tableau d’ensemble, avant de se remettre en
route. D’après les sources éditées et inédites que j’ai pu exploiter jusqu’à
présent, il m’a ainsi paru nécessaire de me préciser le point d’avancement de
mes recherches dans un domaine de cette histoire des populations grecques
d’Italie du Sud et de Sicile au Moyen Age, celui du monachisme et des moines
grecs: j’ai été ainsi amené à constater que les cadres événementiels devaient
être interprétés et qu’à l’intérieur de ceux-ci je pouvais tenter d’opérer
quelque classement en examinant le fait monastique dans l’économie et dans la
société. C’est donc d’une esquisse partielle qu’il s’agit [1].
I.
- Annales
Les travaux scientifiques qui se sont intéressé à l’histoire du monachisme grec
en Italie du Sud et en Sicile ne sont pas, jusqu’à présent, parvenus à imposer
une vue claire du cadre événementiel de cette histoire [2]. Je l’ébaucherais de
la façon suivante.
1.
J’ignore ici à dessein le monachisme grec de l’exarchat de Ravenne proprement
dit, celui de Rome et celui de Naples.
2.
-
P. P. Rodota, Dell’origine, progresso, e stato presente del
rito greco in Italia osservato dai Greci, monaci basiliani, e Albanesi. Libri
tre, II, Rome, 1760, in-4°, 275 p.;
-
P. Batiffol, L’abbaye de Rossano. Contribution à l’histoire de
la Vaticane, Paris, 1891, p. iv-xxxix;
-
J. Gay, L’Italie méridionale et l’Empire byzantin depuis
l’avènement de Basile Ier jusqu’à la prise de Bari par les Normands
(867-1071) (Bibliothèque des Ecoles Françaises d’Athènes et de Rome,
90), Paris, 1904, p. 254-286, 376-386;
-
K. Lake, The Greek Monasteries in South Italy, The
Journal of Theological Studies, 4, 1903, p. 345-368, 517-542; 5, 1904, p.
22-41, 189-202;
-
F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et
en Sicile, t. II, Paris, 1907, p. 584-593;
-
L. T. White, Latin monasticism in Norman Sicily (The
Mediaeval Academy of America. Publication n. 31. Monograph n° 13),
Cambridge, Mass., 1938, p. 16-52;
-
M. Scaduto, Il monachismo basiliano nella Sicilia medievale.
Rinascita e decadenza, sec. XI-XIV, Rome, 1947, in-8°, lx-367 p.;
-
L.-R. Ménager, La «Byzantinisation» religieuse de l’Italie
méridionale (IXe-XIIe siècles) et la politique monastique des Normands d’Italie,
Revue d’Histoire Ecclésiastique, 53, 1958, p. 747-774; 54, 1959, p. 5-40;
-
H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur im
Byzantinischen Reich (Handbuch der Altertumswissenschaft. . ., Iv. von
Müller, 12. Abt., 2. Teil, Bd. 1, Byzantinisches Handbuch, 2. Teil., Bd. 2),
Munich, 1960, p. 227-229.

81
a)
Les origines: VIIe-VIIIe siècles.
Procope de Césarée, dans une description peu claire des régions et des
populations qui occupent l’ancienne «Grande Grèce» sur le littoral de la mer
Adriatique et de la mer Tyrrhénienne, au moment du débarquement des troupes
byzantines, au VIe siècle, cite les Καλαβροί, les Βρίττοι, les
Λευκανοί, les Καμπανοί, les Ἀπούλιοι et les Σαμνῖται, et note que les premiers
Grecs (Ἕλληνες) n’apparaissent qu’en Epire [1]; il semble considérer que
l’Italie du Sud était alors habitée par des Latins; les dernières recherches des
linguistes sur l’origine des dialectes néo-grecs de ces régions paraissent
prouver que les Grecs n’ont jamais disparu de la péninsule [2]. Information
lacuneuse de Procope? Question de nuances? L’historien manque de sources
décisives pour trancher. L’existence d’une importante population grecque en
Sicile, et surtout en Sicile orientale, est, par contre, sûrement attestée par
le grand nombre des inscriptions funéraires grecques du IVe et du Ve
siècle [3]. Mais il manque encore ici la convergence des preuves. Ce qui peut
être considéré comme une hypothèse pour la période précédente, qui reste, — et
cela est indiscutable —, muette sur la présence de moines grecs en Italie du Sud
et en Sicile, fait place à la certitude pour le VIIe siècle; si on
écarte, en effet, à cause de son caractère légendaire la Vie de s. Jean
Damascène qui ferait venir d’Italie (ἐξ Ἰταλίας ὁρμώμενος = Italie du Sud ou
Sicile) le moine érudit Kosmas, qui fut le maître du grand docteur byzantin
[4],
1.
De bello gothico, I, 15 (éd. G. Dindorf, Bonn., 1833, p. 78-80).
2.
C’est la position (convaincante) de St. C. Caratzas, L’origine des dialectes
néo-grecs de l’Italie méridionale, Paris, 1938, qui (p. 17-77) a clairement
résumé les diverses opinions des linguistes; mais tout le problème n’est pas là.
3.
V. Strazzulla, Museum epigraphicum seu inscriptionum christianarum quae in
Syracusanis catacumbis repertae sunt corpusculum, Palerme, 1897. Les
opinions contraires sont rappelées par S. L. Agnello, Silloge di iscrizioni
paleocristiane della Sicilia, Rome, 1953, p. 8-12. La question est seulement
posée. Pour l’existence d’une population grecque à Syracuse au VIe
siècle, on notera que Procope au moment du débarquement retrouve un ami
d’enfance, installé dans le port sicilien pour ses affaires (De bello
vandalico, I, 14, éd. G. Dindorf, Bonn, 1833, p. 371).
4.
Acta SS., Maii, II, Paris-Rome, 1866, p. 112 (trad. lat.), p. II (texte
grec); sur cette vie écrite par Jean de Jérusalem au Xe siècle, voir
M. Jugie, Dict. Théol. Cath., Paris, 1924, s. v°, p. 696, et H.-G. Beck,
Kirche und theologische Literatur, . . ., Munich, 1959, p. 567 (= F.
Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca (Subsidia hagiographica,
n° 8a), Bruxelles, 1957, n° 884).

82
on
conserve la longue lettre théologique de Maxime le Confesseur adressée, entre
616 et 648 «à tous les higoumènes, moines et populations orthodoxes de Sicile»
[1]; ce n’est pas dans le terme «orthodoxe», qui à l’époque couvre tout le monde
chrétien, que l’on cherchera argument, mais dans le fait que la lettre est
écrite en grec. Il y avait donc au milieu du VIIe siècle un certain
nombre d’higoumènes et donc de monastères grecs en Sicile; on connaît seulement,
il est vrai, pour l’époque le nom de quatre d’entre eux, S. Lucia, près de
Syracuse [2], S. Pietro ad Baïas, S. Nicolas et la Capitulana, mais de
nombreuses grottes et de nombreux ermitages restent anonymes [3], et il me
paraît sûr que le pays de Sicile choisi par l’empereur Constant II en 663 pour y
installer la nouvelle capitale de l’Empire constituait alors une province de
population grecque prospère [4].
1.
Migne, P. G., t. 91, col. 112: Τοῖς κατὰ τήνδε τὴν Σικελῶν φιλόχριστόν νῆσον
παροικοῦσιν ἁγίοις πατράσιν ἡγουμένοις τε καὶ μονάζουσι καὶ ὀρθοδόξοις λαοῖς...
Et il paraît certain qu’une partie de ces populations venaient de Syrie, de
Palestine, et, peut-être, d’Egypte, fuyant la migration arabe, et aussi du
Péloponnèse, chassées par la progression slave. Je reviendrai bientôt sur cet
important problème démographique. Pour la date et le sens de la lettre de Maxime
le Confesseur, voir P. Sherwood, An Annotated date-list of the Works of
Maximus the Confessor (Studia Anselmiana ..., 30), Rome, 1952, p. 55.
2.
Vie de s. Zosime, évêque de Syracuse, Acta SS., Mart., III, p. 836.
3.
Liber Pontificalis, éd. L. Duchesne, I, Paris, 1955 (éd. anastatique), p.
354; l’aspect archéologique du problème a été exposé, dans l’état très
fragmentaire où demeure la recherche, par G. Agnello, L’architettura
bizantina in Sicilia (Collezione meridionale diretta da U.
Zanotti-Bianco. Ser. III: Il Mezzogiorno Artistico), Florence, 1952, p. 14,
61-68, 81-88, etc.
4.
L’archéologie est ici une source précieuse de documentation; contentons-nous de
signaler les pièces les plus connues: un anneau d’or nuptial inscrit (VIIe
s.) trouvé à Syracuse (Palerme, Musée national, cat. n° 31), un autre, peut-être
un peu plus ancien (VIe-VIIe s.), acheté à Paterno
(Syracuse, Musée archéologique national, inv. n° 35261), un collier d’or (VIIe
s.) trouvé à Campobello di Mazzara (Palerme, Musée national, cat. n° 825). Les
derniers sondages archéologiques effectués par D. Adamesteanu à Sofiana (voir le
compte-rendu à paraître dans le prochain fascicule du Bollettino d’Arte)
ont apporté au jour un certain nombre de bijoux de la fin du VIe ou,
plus probablement, du VIIe siècle. Devant ces découvertes
occasionnelles, faites par les archéologues de l’Antiquité, on se demande quand
l’archéologie byzantine ne sera plus considérée comme une parente pauvre de
l’archéologie classique: pour l’histoire de la Sicile du VIe au XIe
siècle, la documentation la plus sûre et quelquefois la seule est archéologique
et elle est encore à rechercher; on peut bien penser qu’il n’est pas encore
question d’une future carte archéologique byzantine de la région. Pour la
Calabre et les Pouilles, le problème est le même; il faudrait en premier lieu au
moins dater les grottes monastiques et distinguer celles-là des autres, car on
en connaît certaines qui peuvent remonter au VIIe siècle et avoir été
occupées par des moines de Syrie ou de Palestine (R. Jurlaro, Sulle
precedenze cultuali paleocristiane di alcune grotte greche eremitiche del
Salento, Bollettino Bad. Gr. Grottaferrata, n. s., 16, 1962, p.
25-32); on peut aussi citer les objets d’art découverts in situ, comme les deux
très belles boucles d’oreilles (VIe-VIIe s.) qui
proviennent d’une tombe des environs d’Otrante (Tarente, Musée national, inv. n°
22617-22618), etc. Voir les dépouillements partiels édités par P. Orsi, Sicilia Bizantina, vol. I (Collezione meridionale diretta da U.
Zanotti-Bianco. Ser. III: Il Mezzogiorno Artistico), Rome, 1942, in-4°, 249
p., et G·. Agnello, Le arti figurative nella Sicilia bizantina (Istituto
siciliano di studi bizantini e neoellenici. Testi e monumenti pubblicati da B.
Lavagnini. . . Monumenti, 1), Palerme, 1962, in-4°, 374 p.

83
En
confisquant les biens de l’Eglise de Rome en Sicile et en Calabre, Léon III, en
731, arrachera pour longtemps ces régions à l’autorité du pontife romain, en
donnant aux populations grecques une nouvelle raison de s’épanouir
[1].
b)
Naissances et renaissances: IXe-XIIe siècle.
On
ignorera toujours, faute de sources, la nature et l’extension du monachisme grec
(et même peut-être de la population grecque) en Sicile jusqu’au XIe
siècle [2]; en particulier on ne connaît du sort fait à celui-ci par les Arabes
que ce qu’en disent quelques hagiographes, qui ont fait des raids arabes le
thème de l’exode et l’origine de migrations vers le Nord (en particulier vers la
Calabre) [3].
1.
F. Dölger, Regesten (Corpus der Griechischen Urkunden. . ., Reihe A, Abt. 1, 1. Teil), Munich, 1924, n° 301.
2.
Les iconodules, en tout cas, ne sont pas venus grossir en masse la population
grecque de Calabre ou de Sicile, car ils auraient retrouvé dans ces régions les
lois impériales, qui les avaient amenés à s’exiler; les victimes de
l’iconoclasme se sont réfugiées dans les territoires de l’Italie qui ne
faisaient pas partie de l’Empire byzantin, à Rome, à Naples et dans les environs
(voir Vie de s. Stéphane le Jeune, Migne, P.G., t. 100, col. 1117, 1120).
Si des moines iconodules ont pris le chemin de Lipari, comme le signale Théodore
du Stoudiou dans l’une de ses lettres, c’est sous bonne garde et pour y vivre
sous surveillance: Ὑπὲρ τίνος ἐν Λιπάρει τῇ ὑπερέκεινα Σικελίας ἀδελφοὶ ἡμῶν
φυλακῇ τηρούμενοι; (Migne, P.G.,t. 99, col. 1071). Il ne peut s’agir,
ici, de mouvement démographique d’une valeur sensible.
3.
Une semblable légende voudrait que le moine Théodore eût été chassé de son
monastère de l’Olympe en Bithynie par un raid arabe, qui serait donc à l’origine
de la fondation du monastère du Stoudiou. Pour l’Italie, lire les vies de s.
Elias de Enna, de Léon-Luc de Corleone, de s. Elias le Spélaiôtès, de s. Luc de
Demenna (F. Halkin, Bibliotheca Hagiographica Graeca ..., Bruxelles,
1957, nos 580, 581; Bibliotheca Hagiographica Latina, Bruxelles,
1900-1901, nos 4842, 4978.)

84
Il
est attesté, certes, qu’un certain nombre de moines furent tués à la chute de
Syracuse (878) [1] qu’il y ait eu des assassinats et des déportations, le fait
est certain, mais il n’y eut pas de persécution; s’il y eut des départs de
colonies monastiques siciliennes vers le continent et une progression de
celles-ci vers le nord de la Calabre et la Lucanie, ils furent provoqués plus
par l’insécurité économique et le goût de certains moines pour les retraites
éloignées que par les sévices du nouvel occupant [2]. Au reste, plus d’un
monastère grec poursuivit sous le régime arabe en Sicile sa paisible existence:
S. Maria di Vicari dans le Val di Mazzara, S. Angelo di Brolo, S. Filippo e S.
Barbaro dans le Val di Demenna, etc. [3]. Les dévastations et les pillages des
cavaliers arabes doivent être ramenés à leur juste mesure; les récits des
contemporains eux-mêmes nous y invitent: une troupe arabe parcourtelle la région
du Merkourion (haute vallée du Lao), les moines quittent leurs couvents et leurs
ermitages pour se réfugier dans la montagne ou dans le καστέλλιον proche sous la
protection de la troupe; la bourrasque passée, ils regagnent leurs cellules,
pour constater que leurs pauvres affaires leur ont été dérobées [4]; et la vie
reprend. S. Sabas fonde-t-il un monastère sur la rive du Sinni, non seulement il
choisit le voisinage d’un καστέλλιον mais il assure, en outre, la première
défense de son couvent en protégeant les abords par un rempart (προτείχισμα)
[5]; et, face aux attaques ennemies, il ne faudrait pas penser que les moines
grecs fuyaient toujours ou cherchaient toujours le martyre:
1.
Voir M. Scaduto, Il monachismo basiliano . . ., Rome, 1947, p. xxvi.
2.
Je me suis élevé récemment contre cette construction soutenue encore par L.-R.
Ménager, La «Byzantinisation» religieuse de l’Italie méridionale. . ., Revue
d’Histoire Ecclésiastique, 53, 1958, p. 747-774, dans l’Introduction
à mon volume, Les actes grecs de S. Maria di Messina. Enquête sur les
populations grecques d’Italie du Sud et de Sicile (Istituto siciliano di
studi bizantini e neoellenici. Testi e monumenti pubblicati da B. Lavagnini . .
. Testi, 8), Palerme, 1963, p. 19-29, et dans un article récent, Inchiesta sulla popolazione Greca della Sicilia e della Calabria nel Medioevo,
Rivista Storica Italiana, Ί5, 1, 1963, p. 53-68. Je crois pouvoir nier
énergiquement les migrations massives des populations grecques imaginées par
l’auteur.
3.
M. Scaduto, Il monachismo basiliano . . ., Rome, 1947, p. 69.
4.
Vie de s. Elias le Spélaiôtès, Acta SS., Sept., III, § 69, p. 876; vie de
s. Nil de Calabre, Acta SS., Sept., VII, 1867, § 30, p. 280.
5.
Vie de s. Sabas, éd. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes SS. Sabae et Macarii
juniorum e Sicilia, Rome, 1893, § 9, p. 17-18.

85
s.
Luc de Demenna, quand une troupe arabe est en vue, choisit les moines les plus
courageux et les plus robustes du couvent et, tel un chef de guerre, enfourche
son cheval et marche à l’ennemi; le texte qui raconte le fait ajoute que les
Arabes, terrifiés par l’aspect de la monture du saint, qui leur apparaissait
environnée de flammes, prirent la fuite [1]; on peut penser que l’allure décidée
des compagnons de s. Luc et les armes qu’ils portaient auraient suffi à faire
rebrousser chemin à l’ennemi. L’insécurité politique a donc eu pour conséquence
la construction de monastères fortifiés et c’est la pénurie économique qui, dans
ces régions d’équilibre vital précaire, a pu causer des déplacements sensibles
de population [2]; un exemple, la région d’Agira, au sud de l’Etna, qui vient
d’être parcourue par des bandes arabes, au milieu du Xe siècle, est
victime d’une famine si totale que, si j’en crois un hagiographe, les parents
mangèrent leurs enfants et les enfants leurs parents; on comprend la fuite des
moines du couvent S. Filippo, situé au centre du fléau, vers les côtes
calabraises [3]. Dans une autre région, et au milieu du XIe siècle,
Drogo et sa bande normande, ravagent toute la région du Latinianon; le monastère
S. Nicolas de Trypa, mis à sac, fut abandonné par son higoumène, Hilarion: les
années passèrent, les désordres et l’insécurité ne diminuèrent pas, le monastère
et ses terres retournèrent à la friche [4]. Telle est donc l’ambiance; mais je
laisse dans l’ombre un problème démographique plus général qu’il faudra poser.
Peut-on localiser sur le terrain les principales institutions grecques pendant
la grande période du monachisme’? Ou, au moins, leur aire d’extension? Question
d’importance, car, en relisant les sources hagiographiques, on reste convaincu
que le monastère constitue un élément essentiel de fixation pour la population
(lieu de pèlerinage ou point d’exploitation rurale et centre d’échanges). En
Sicile, autour de Syracuse, de Taormine [5],
1.
Vie de s. Luc de Demenna, Acta SS., Oct., VI, p. 340.
2.
Voir A. Guillou, Inchiesta sulla popolazione Greca . . ., Rivista
Storica Italiana, 75, 1, 1963, p. 63.
3.
Vie de s. Sabas, éd. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes . . ., Rome, 1893,
§ VI, p. 13.
4.
Gertrude Robinson, History and Cartulary of the Greek Monastery of St. Elias
and St. Anastasius of Carbone, II, 1, Cartulary (Orientalia Christiana,
XV, 2), Rome, 1929, n° VIII-57, p. 172-175. La date du document reste à établir,
l’auteur ne s’est pas rendu compte que les éléments de celle-ci, 6589 et
indiction 9, ne concordent pas.
5.
M. Scaduto, Il monachismo basiliano ..., Rome, 1947, p. xxv-xxvi.

86
Agira [1], le val de Mazzara, le val de Demenna, toute la région de Rainetta,
Troina, et, naturellement, Messine [2]; en Calabre et Lucanie, les centres sont Reggio, Armo, Penditattilo, «Les Salines» (Melicuccà, Sinopoli, Seminara,
Tauriana, S. Cristina) [3], la région de Mesiano
[4], celle du Mont Mula près de Cassano [5], la région du Merkourion, sur les pentes occidentales du Mont
Pollino [6], le Latinianon, sur le cours moyen du Sinni, avec Carbone, Teana,
Chiaromonte, Noepoli (au Moyen Age Noa), et Kyr-Zosimo [7], toute la vallée du Cilento, jusqu’aux portes de Salerne
[8], la région du Vulture [9], celle de Tricarico, avec la Théotokos del Rifugio
[10]; dans les Pouilles, les recherches
archéologiques ont permis de reconnaître habitats monastiques ou lieux de culte
entre Otranto et le cap S. Maria di Leuca, entre Brindisi, Monopoli et Andria,
enfin autour de Gravina, Matera et peut-être Massafra [11]; on connaît également
l’existence de nombreux monastères grecs à Bari [12]. Aucune de ces fondations
n’est datée, on s’en doute; les plus récentes ont choisi, parfois, des lieux de
culte ou des centres monastiques abandonnés [13]. Mais cette préhistoire est
difficile à saisir.
1.
Acta SS., Mart., I, p. 99.
2.
M. Scaduto, Il monachisme basiliano . . Rome 1947, p. xxvi-xxxii.
3.
Voir, par exemple, vie de s. Elias de Enna (éd. G. Rossi Taibbi, Vita di
sant’Elia il Giovane (Istituto siciliano di studi bizantini e
neoellenici. Testi e monumenti pubblicati da B. Lavagnini. . ., Testi, 7, Vite
dei santi siciliani, III), Palerme, 1962, ligne 595, p. 44, 205-206, et la
carte hors-texte.
4.
Ibidem, ligne 784, p. 58.
5.
Vie de s. Léon-Luc de Corleone, Acta SS., Mart., 1, p. 100.
6.
Voir, par exemple, vie de s. Sabas, éd. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes
. . ., Rome, 1893, § 7, p. 14.
7.
Ibidem, § 9, p. 17-18.
8.
B. Cappelli, I Basiliani nel Cilento Superiore, Bollettino Bad. Gr.
Grottaferrata, n.s., 16, 1962, p. 9-21.
9.
J. Gay, L’Italie méridionale et l’Empire byzantin ..., Paris, 1904, p.
267.
10. A. Guillou-W. Holtzmann, Zwei Katepansurkunden aus Tricarico, Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, 41, 1961, p. 19, 1.
43 et p. 27-28.
11. Alba Medea, Gli affreschi delle cripte eremitiche pugliesi (Collezione
meridionale dir. da U. Zanotti-Bianco. Ser. III, Il Mezzogiorno artistico),
Rome, 1939, p. 21; E. Jacovelli, Gli affreschi bizantini di Massafra,
Massafra, 1960, in-fol., 45 pages.
12. Gertrude Robinson, op. cit., p. 138, η. 1.
13. Vie de s. Sabas, éd. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes ..., Rome,
1893, § 3, p. 8; vie de s. Lue de Demenna, Acta SS., Oct., VI, p. 340.

87
Et
ici s’achève ce que j’appellerais l’époque byzantine du monachisme grec d’Italie
du Sud et de Sicile; retenons qu’il déborde les «frontières», assez imprécises
d’ailleurs, entre les thèmes byzantins et les principautés lombardes, et qu’il
se maintient dans la Sicile arabe.
Avec l’arrivée des princes normands en Italie du Sud, on assiste à la création
ou à la restauration de grands centres monastiques, ce qui n’est pas contraire
aux traditions monastiques grecques, comme on le verra plus bas, mais ce qui
manifeste de la part du pouvoir un désir de centralisation; les anciennes
institutions sont ainsi placées sous l’autorité de ces centres: S. Elias de
Carbone, pour la Basilicata, S. Jean le Moissonneur à Stilo pour l’Aspromonte,
S. Maria del Patir à Possano pour la Sila, S. Nicolas de Casole près d’Otranto
pour la Lucanie et les Pouilles, S. Salvatore di Messina pour la Sicile
[1];
concentration nécessitée par l’état de décadence de nombreux couvents, ou voulue
par la structure du nouveau royaume? J’ai cru pouvoir établir, après une
enquête particulière dans quelques dossiers d’archives que le niveau
démographique et culturel des populations grecques de Calabre s’était maintenu
jusqu’à la fin du XIIe siècle; si je ne me trompe, on peut donc
admettre la volonté des princes normands de contrôler les nombreuses
institutions monastiques grecques par la fondation de couvents importants et
richement dotés, tout en tolérant la fondation ou la restauration de couvents
grecs dans les régions de population grecque majoritaire.
c)
Extinction: XIIIe-XVe siècle.
Le
monachisme grec, comme la population grecque en général, est entré dans le
vêtement normand qui l’étouffera: coupé, désormais, des grands foyers orientaux
de spiritualité et de culture, au milieu d’une population latine de plus en plus
largement majoritaire, bientôt même, sous les Angevins et les Aragonnais, dans
un climat d’insécurité ou de guerre permanente, quelquefois d’hostilité marquée
de la part du pouvoir, il s’étiole peu à peu; le recrutement devient impossible,
la discipline est mal consentie, la culture, pour les meilleurs, a été
abandonnée pour l’ascèse la plus extravagante [2]. Les papes tenteront de
réformer «l’Ordre de s. Basile» comme disait la Curie romaine; mais la commende
avait achevé sur le plan matériel ce qui demeurait encore debout.
1.
K. Lake, The Greek Monasteries in South Italy, The Journal of
Theological Studies, 5, 1904, p. 24-27.
2.
Vie de s. Philarétos, Acta SS., April., I, p. 607. 608, 609, etc.

88
Bessarion, malgré tout son zèle, travaillera en vain à relever les institutions
mortes; les deux visiteurs qu’il enverra en inspection dans les monastères de
Calabre, Athanase Chalkéopoulos et Macaire, lui rapportent en 1457-1458 un long
procès-verbal qui constitue le dernier jalon historique de cette histoire de
huit siècles: beaucoup de monastères sont en ruines, les moines sont tous
latins, les biens qui ne sont pas en friche sont exploités par des gens avides
et sans scrupules [1]. L’histoire du monachisme grec en Italie du Sud et en
Sicile doit être close ici.
Telles sont les annales commentées de ce monachisme, dont je voudrais essayer
maintenant de comprendre le rôle dans l’histoire de la civilisation de ces
régions.
II. - Le fait monastique dans l’économie et dans la société
Pour Basile de Césarée, maître incontesté des moines orientaux, l’idéal du moine
était de découvrir la mesure entre le Βίος πρακτικός et le Βίος θεωρητικός, —
traduisons la vie active et la vie contemplative —, pour atteindre Dieu et
assurer ainsi le salut de son âme [2].
A) Βίος πρακτικός, ou monachisme grec et économie en Italie du Sud et en
Sicile.
«Il convient que le moine se livre à des travaux appropriés à son état, de ceux
qui ne comportent aucun trafic ou de trop grands tracas ou des gains scandaleux,
de ceux qui peuvent être exécutés aussi à l’intérieur du monastère, où nous nous
trouvons le plus souvent, afin que, d’une part, le travail soit fait et que,
d’autre part, l’ἡσυχία soit conservée. . .»,
dit l’auteur des Διατάξεις [3], qui conclut, ailleurs, que ce sont les travaux
des champs qui lui paraissent le mieux convenir à l’état monastique
[1];
1.
M.-H. Laurent – A. Guillou, Le «Liber Visitationis» d’Athanase Chalkéopoulos
(1457-1458). Contribution à l’histoire du monachisme grec en Italie
méridionale (Studi e testi, 206), Cité du Vatican, 1960, p. xxiv-xlv.
2.
Migne, P.G., t. 31, col. 881: Ὁ ἀσκητικὸς βίος ἕνα σκοπὸν ἔχει, τὴν τῆς
ψυχῆς σιοτηρίαν.
3.
Migne, P.G., t. 31, col. 1360; la nécessité du travail manuel est maintes
fois soulignée par le père du monachisme byzantin, voir encore col. 772, 876,
1009-1018, 1349.

89
mêmes prescriptions chez Dorothée de Gaza au VIe siècle
[2] et chez
Théodore de Stoudiou, le réformateur du monachisme grec, au IXe
siècle [3]; il ne manque plus aucun jalon jusqu’à nos moines défricheurs
d’Italie du Sud et de Sicile [4].
C’est bien là, en effet, l’activité la plus impressionnante des moines grecs en
Sicile, en Calabre, en Lucanie et jusque dans les Pouilles au Xe
siècle; ils transforment la forêt ou la lande en terres de culture (χωράφια dans
les textes grecs); s. Elias le Spélaiôtès au début du siècle fait couper des
arbres immenses à ses disciples [5], le père de s. Sabas le Jeune près d’Agira,
en Sicile, au milieu du siècle doit gagner sur la nature à la force de ses bras
l’espace où il élèvera oratoire et skite [6], à la même époque Jônas, moine de
la Théotokos del Rifugio au sud de Tricarico, défriche un large espace de terres
voisines de son couvent [7], Sabas et Macaire défrichent dans la région du Merkourion, dans la haute vallée du Lao
[8], puis au nord-est du mont Pollino,
dans la vallée moyenne du Sinni, dans cette région appelée Latinianon
[9]. Les
Vies de Saints affirment donc que les moines grecs défrichaient au Xe
siècle et certaines nous laissent déduire qu’au siècle précédent il en fut
autant:
1.
Migne, P.G., t. 31, col. 1016-1017.
2.
Migne, P.G., t. 88, col. 1649, 1652. La bibliographie sur l’abbé Dorothée
se trouve dans H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur. . .,
Munich, 1959, p. 396.
3.
Grande Catéchèse, éd. J. Cozza-Luzi, Novae Patrum bibliothecae ab Aug. card.
Maio collectae tomi noni pars II, Rome, 1888, p. 48; Petite Catéchèse,
éd. E. Auvray, Theodori Studitis praepositi, Parva Catechesis, Paris,
1891, p. 208: Τοῖς ἐργοχείροις ἡμῶν προσέχοντες, ταῖς ψαλμωδίαις, ταῖς
στιχολογίαις, ταῖς ἀγνώσεσιν ...., et ρ. 298; voir J. Leroy, La réforme
studite, dans Il monachesimo orientale (Orientalia Christiana
Analecta, 153), Rome, 1958, p. 191-192. Sur Théodore, on trouvera la
bibliographie dans H.-G. Beck, Kirche und theologische Literatur ...,
Munich, 1959, p. 491-495.
4.
On verra plus bas l’influence exercée par le réformateur constantinopolitain sur
les monastères grecs de l’Italie du Sud et de la Sicile.
5.
Acta SS., Sept., III, § 68, p. 875: Ὡς γὰρ προετρέπετο τοὺς οἰκείους
μαθητὰς δένδρα παμμεγεθῆ ἐκκόπειν. . .
6.
Ed. J. Cozza-Luzi, Ηistoria et laudes . . ., Rome, 1893, § 3, p. 8: Τὴν
ὕλην διακαθάρας . . .
7.
A. Guillou – W. Holtzmann, Zwei Katepansurkunden aus Tricarico, Quellen und Forschungen . . ., 41, 1961, p. 26 et 27, 1. 19-20: Ὁ Ἰωνᾶς
ἐκεῖνος, ὁ τὸν τόπον αὐτὸν ὑλοκοπήσας καὶ ἐκκαθάρας μοναχὸς ὢν τῆς τοιαύτης
μονῆς . . .
8.
Ed. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes . . ., Rome, 1893, § 7, p. 15.
9.
Ed. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes . . ., Rome, 1893, § 9, p. 17: Καὶ
δὴ τὴν μὲν ὕλην ἀμφιλαφῆ οὗσαν ἀνακαθαίρει . . .

90
Jônas, près de Tricarico ne fait que poursuivre l’œuvre commencée par ses
prédécesseurs [1], de même Sabas au Merkourion
[2] et Elias aux Salines et ici
le pionnier a dû être Elias de Enna cinquante ans plus tôt [3], etc.; le grand
moment des défrichements en Italie du Sud fut-il le Xe siècle ou même
plus précisément la première moitiée du Xe siècle? J’en ai
l’impression, et aucun texte n’y contredit.
Qui dit défrichements dit accroissement de la demande en biens de consommation,
même si, ici, ils sont très modestes. Cet accroissement peut-être dû à une
montée de la démographie, dont l’origine la plus simple serait à rechercher dans
l’Empire byzantin (le Xe siècle est aussi l’époque des défrichements
monastiques au Mont-Athos [4] et au Latros [5]), si on admet que les migrations
locales ne sont pas importantes en volume. C’est une hypothèse de recherche.
Qui dit défrichements dit mise en exploitation de nouvelles terres, le plus
souvent après écobuage; Sabas et Macaire trouvent-ils dans le Merkourion un site
qui leur semble propice pour un établissement monastique, ils détruisent arbres
et buissons par le feu, assainissant ainsi la terre qui se trouve prête pour une
culture de dix à quinze ans [6].
Qui dit défrichements dit, enfin, fixation au sol d’une population rurale; les
premiers bénéficiaires en sont, naturellement, les moines. Dans leur fuite les
moines parviennent en un lieu désert près de la mer, ils découvrent un oratoire
:
1.
Le monastère de la Théotokos del Rifugio auquel appartient Jônas menait, avant
même la donation que lui fit Jônas, une existence normale: il avait conquis son
existence sur la forêt; voir A. Guillou-W. Holtzmann, Zwei Katepansurkunden
aus Tricarico, Quellen und Forschungen. . ., 41, 1961, p. 27.
2.
Il trouve à son arrivée une véritable cité monastique, élevée avant lui aux
dépens de la forêt; voir éd. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes . . .,
Rome, 1893, § 7, p. 14.
3.
G. Rossi Taibbi, Vita di sant’Elia . . ., Palerme, 1962, ligne 595, p.
44.
4.
Ph. Meyer, Die Haupturkunden fur die Geschichte der Athosklöster,
Leipzig, 1894, p. 105 (Typikon d’Athanase).
5.
H. Delehaye, Vita s. Pauli junioris in monte Latro cum interpretatione Latina
Jacobi Sirmondi S. J., Analecta Bollandiana, 11, 1892, p. 14-15.
6.
Vie de s. Sabas, éd. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes. . ., Rome, 1893,
§ 9, p. 17-18. C’est l’écobuage; sur les ressources, maigres mais diverses, de
ces sols voir A. Guillou, Les actes grecs de S. Maria di Messina . . .,
Palerme, 1963, p. 26-29, et id., Inchiesta sulla popolazione Greca. . .,
Rivista Storica Italiana. 75, I. 1963, p. 61-63.

91
ils voient là le dessein de Dieu; ils défrichent donc l’emplacement nécessaire à
leur installation, construisent un nouveau sanctuaire, réunissent un grand
nombre de disciples et fondent ainsi un très célèbre couvent, où ils rivalisent
dans l’action et la contemplation. Ceci est un exemple type: celui de la
naissance du monastère Saint-Laurent dans le Latinianon [1]. On se doute bien
que les bâtiments conventuels ne suffisent pas pour constituer la cellule
économique qui se forme; les textes nous permettent d’y ajouter seulement le
moulin à grain, et, une fois, une saline [2]. Il faut suppléer le silence des
sources et nantir le nouvel établissement des installations et de l’équipement
requis par toute exploitation agricole. Les moines, dit, en effet, l’un des plus
brillants des fondateurs calabrais, s. Nil, qui doivent se suffire à euxmêmes,
font donc tous les travaux des champs [3]. C’était aussi les consignes laissées
par Théodore de Stoudiou à ses moines de Constantinople [4].
Les moines ne suffisent bientôt plus à l’exploitation des terrains qu’ils
gagnent sur la friche, ils font alors appel à la main d’œuvre civile et prennent
ainsi place, sous le régime byzantin, dans la classe enviée des propriétaires
terriens. C’est ainsi que le monastère de la Théotokos del Rifugio, près de
Tricarico, fondé peut-être au début du Xe siècle, reçoit de l’un de
ses moines, à sa mort, une belle étendue de terrains proches du couvent;
l’higoumène, Kosmas, appelle des ἐλεύθεροι, paysans dégagés d’obligations
vis-à-vis du fisc, pour exploiter le nouveau domaine; quinze années suffisent
pour que la nouvelle exploitation soit organisée et assez prospère pour
intéresser le cadastre et le fisc impériaux: le représentant de l’administration
impériale, à cette date, en effet, reconnaît par un document solennel au
monastère la propriété du nouveau chôrion (χωρίον),
1.
Vie de s. Sabas, éd. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes . . ., Rome, 1893,
§ 9, p. 17-18.
2.
Vie de s. Elias le Spélaiôtès, Acta SS., Sept., III, § 43, p. 86: . . . ἐργασάμενος τήν τε ἁλικὴν εἰς χρείαν τῆς μονῆς καὶ μικρὸν ἐργαστήριον εἰς τὸ τὸν
σῖτον ἀλήθειν . . .
3.
Vie de s. Nil, Acta SS., Sept., VII, § 31, p. 280: Ὄντος δὲ αὐτοῦ ἐν τῷ
μοναστηρίῳ τὸ πρὶν διὰ τὸν θερισμὸν . . .
4.
Pour Théodore le monastère est une cité économiquement autonome, comme l’a vu J.
Leroy, La réforme studite, dans Il monachesimo orientale (Orientalia
Christiana Analecta, 153), Rome, 1958, p. 191-192.

92
mot qui désigne la circonscription fiscale dans la langue administrative grecque
[1].
Dans le monde religieux de la vie byzantine, il va de soi que la nouvelle
circonscription fiscale était dégrevée de toute charge vis-à-vis de l’État
[2].
Les revenus de l’exploitation pouvaient donc être consacrés à son entretien et à
son extension. Mais les produits du sol ne constituaient pas toujours l’unique
ressource du monastère. Non contents d’abandonner aux institutions monastiques
les taxes qu’ils étaient en droit de percevoir sur les propriétés, le
gouvernement byzantin, l’Empereur, les grands personnages de l’Empire,
assuraient leur salut éternel en dotant richement les couvents qui étaient, à
leurs yeux, les intermédiaires efficaces entre la terre et le ciel: le monastère
des Salines, fondé par Elias de Enna, reçoit ainsi de l’empereur Léon VI un
grand nombre de biensfonds (κτήματα) et une quantité importante de revenus
(πρόσοδοι) [3]. C’est un exemple.
La
puissance économique de cette population rurale, groupée autour du propriétaire
gros ou petit, le monastère, fut certainement un élément important de la vie
agricole (sinon commerciale) de ces régions, par son unité et par sa stabilité.
Le monastère est une cité économique autonome et hiérarchisée, ici, comme
ailleurs dans l’Empire. L’image juridique de ce fait économique se trouve encore
dans Théodore de Stoudiou [4].
L’higoumène devient donc, sinon propriétaire
[5], du moins gérant responsable des
domaines qui lui sont confiés.
1.
Voir A. Guillou – W. Holtzmann, Zwei Katepansurkunden aus Tricarico, Quellen und Forschungen, . . ., 41, 1961, p. 26-28.
2.
Ibidem.
3.
G. Rossi Taibbi, Vita di sant’Elia..., Palerme, 1962, ligne 1632, p. 120.
4.
Voir par exemple, la Grande Catéchèse, éd. J. Cozza-Luzi,
p.
13: Μὴ διαιρούμενοι ταῖς γνώμαις, μηδὲ ἐθελοθρησκοῦντες ταῖς ἐπιθυμίαις, μηδὲ
μεριζόμενοι ταῖς σαρκικαῖς σχέσεσι, μηδὲ κατατεμνόμενοι ταῖς ἰδιοκτημοσύναις,
ἀλλ’ ἐν ὁ ὶ (?) καὶ τῷ αὐτῷ πνεύματι συμβιβαζόμενοι καὶ συναριθμούμενοι, καὶ
πρὸς μίαν ἔφεσιν, δουλεύειν καὶ εὐαρεστεῖν Κυρίῳ, ὡς ἐν ταύτῃ τῇ ἀγγελικῇ καὶ
κοινοβιακῇ ζωῇ·
et
p. 38,
Ἵνα ἕκαστος καθὼς διετάχθη ἐν τῇ διακονίᾳ αὐτοῦ παραμένων χρησιμεύση, ῥυθμίζων
ἑαυτόν ἐν πάση ἀγαθῇ πράξει·
et
p. 202,
πρὸς τὸ κοινῇ γὰρ σύμφερον ἅπαντες ἀποσκοποῦμεν . . . (voir Petite Catéchèse,
éd. A. Auvray, p. 151, 437).
5.
On sait que d’après le droit canon byzantin les moines ne peuvent être
propriétaires (Photius, Syntagma Canonum, P.G., t. 104, col. 836:
Οἱ μοναχοὶ οὐδὲν ἴδιον ὀφείλουσιν ἔχειν); le sujet est à traiter.

93
Le
taxiarque Kalôn, père du spatharokandidat Jean, avait donné - tout qui lui
appartenait, terrains, vignes, arbres fruitiers, moulin, situés sur le
territoire du château-fort qu’il avait construit, au moine Gérasimos, pour qu’il
y élevât un sanctuaire et un monastère, avec cette clause que, si Gérasimos ne
veillait pas à la prospérité de la propriété (εἰς αὔξησιν τοῦ τοπίου), celle-ci
serait confiée à un autre moine. Le donateur mort, le spatharokandidat Jean
constate l’incurie de l’higoumène; il se met d’accord avec son frère pour
congédier Gérasimos et confie l’exploitation et le monastère S. Nicolas au moine
Hilarion. Les déprédations commises par les Normands, la chute du régime
byzantin en Lucanie et en Calabre, sont accompagnées ou suivies dans la région
de troubles économiques parfois déterminants: le moine Hilarion, quant à lui,
renonce et abandonne son couvent, après avoir restitué au propriétaire la
convention écrite qui lui en donnait la responsabilité spirituelle et
temporelle. Quelques années après, le spatharokandidat confie le domaine et le
couvent à l’important monastère voisin de S. Anastasios de Carbone
[1].
Un
siècle plus tard, en Sicile normande, Oulô, fille de Jean Grapheus, un grand
officier de l’administration royale, et son mari Roger, un haut fonctionnaire de
Messine, fondent et dotent deux monastères grecs, l’un de femmes à Messine même,
l’autre d’hommes sur la rivière Bordonaro, au sud de la ville. On a conservé le
texte de la convention écrite (ἔγγραφος συμφωνία) passée entre la donatrice (car
elle cède son bien) et l’higoumène Arsénios pour le second monastère: celui-ci
s’engage à célébrer chaque année un office en l’honneur de la donatrice et un
autre en l’honneur de son époux, et à prendre soin, avec une égale attention,
des intérêts spirituels et temporels du couvent. Oulô conserve, sa vie durant,
la propriété de ses biens qui, à sa mort, passeront à la communauté
[2].
Jusqu’ici je ne vois rien de changé dans le régime de gestion des monastères
entre l’époque normande et l’époque byzantine. Ce n’est qu’une apparence.
Lisons, en effet, plus attentivement. Le nouvel higoumène est choisi en 1189 par Oulô, qui, en principe pourtant, a donné son bien au monastère,
1.
Gertrude Robinson, op. cit., n° VIII-57, p. 173-174.
2.
Une copie du document, faite en 1731, par Joseph Vinci, prôtopapas des Grecs de
Messine, est conservée à la Bibliothèque Communale de Palerme (Ms. QQ. H. 237,
fol. 15-19v°) avec une traduction latine de l’auteur (fol. 417-419 v°). Elle est
éditée et commentée dans mon ouvrage, Les actes grecs de S. Maria di Messina
. . ., Palerme, 1963, Appendice II, p. 197-214.

94
et
avec l’accord des boni homines (χρήσιμοὶ ἄνδρες), représentants de la
juridiction gracieuse qui assistent le propriétaire; les mêmes peines
spirituelles et financières (très lourdes) sanctionnent l’higoumène qui
négligerait ses devoirs de chef religieux et celui qui négligerait ses devoirs
de chef d’exploitation; d’autre part, la redevance annuelle, fort élevée, qui
grève la donation et qui est destinée, d’après les termes du contrat, à payer
les frais du culte consacré à la mémoire des deux époux donateurs, est un cens,
le terme même employé (κατετούσιον) ne laisse aucune place au doute: enfin, le
«seigneur» du couvent, c’est-à-dire la donatrice et sa famille, y auront
toujours droit au gîte, au couvert et aux honneurs traditionnels: la scène se
passe en terre féodale normande, la propriétaire grecque loue son bien
(monastère et exploitation agricole) à l’higoumène et renonce à celui-ci
seulement à sa mort en faveur du monastère [1]. L’higoumène (προεστώς) reçoit,
temporairement, délégation d’autorité sur la cellule féodale que constitue le
monastère (biens-fonds et personnes, en particuliers les deux serfs mentionnés
dans le document), avant de devenir seigneur lui-même par élection en principe
de la communauté [2].
C’est dans cette hiérarchisation des liens personnels et matériels, propre aux
institutions féodales et ignorée des institutions grecques au Moyen Age, que je
crois pouvoir trouver l’origine de la formation des grands centres monastiques
grecs de l’époque normande, témoins heureux d’une politique intéressée
peut-être, mais avisée. Je ne puis déterminer le sens de ces créations de la fin
du XIe siècle et du XIIe siècle ou de telle ou telle
naissance, avant de les avoir localisées géographiquement toutes, d’une part,
et, d’autre part, avant d’avoir fixé la courbe économique de ces régions entre
le début et la fin du XIe siècle.
Etendons le champ d’observation du problème. Lors de l’arrivée des Normands, S.
Anastasios de Carbone est un monastère prospère: il possède le monastère de
l’Archistratègos au nord-ouest de Chirico, celui de la Mère de Dieu, tous les
deux dans le Latinianon, le métoque de S. Sofia à Bari, le monastère de la
Théotokos de Casanite, l’église de S. Pancrace, et il a rassemblé sous son
autorité (spirituelle et économique) les skites, lauree, couvents et autres
ermitages de Noia et d’Armento,
1.
Ibidem.
2.
Ibidem.

95
Tout ceci paraît avoir été l’œuvre du second Luc peu avant le milieu du XIe
siècle. Les seigneurs normands de Carbone, les Chiaromonte, vingt-cinq ans plus
tard par leurs donations accroissent considérablement les propriétés du
monastère, leurs successeurs au XIIe siècle feront du monastère
byzantin un redoutable concurrent des fondations bénédictines latines. Dès la
fin du XIe siècle il a réuni sous son contrôle tous les petits
monastères grecs de la région, et, plus tard, tous ceux compris à l’intérieur
d’une ligne réunissant Salerne, Eboli, Gonza, Melfi, jusqu’au Bradano, suivant
la côte ensuite jusqu’à Policoro et Cerchiara (moins Cassano, possession de
l’évêque de Bari), longeant la vallée du Lao, rejoignant Belvedere au Sud pour
suivre enfin de nouveau la côte jusqu’à Salerne [1]. La puissance de l’higoumène
Hilarion, au milieu du XIIe siècle, lui permet de se défendre avec
succès en justice contre les plus grands seigneurs; je pense au procès qu’il
gagna contre Robert, katépan de la vallée du Sinni [2]. Premier exemple d’une
baronnie monastique féodale née d’un centre monastique grec déjà prospère.
Observons maintenant une création: celle de Saint-Sauveur de Messine. Je dis
tout de suite que l’image que l’on en connaît restera floue, tant que les
problèmes posés par la reconstitution des archives du monastère n’auront pas été
examinés et tant que l’édition commentée des textes enfin, acceptent une règle
de communauté et livrent le combat connus n’aura pas été entreprise par un
spécialiste. Je vois cette création, pour le moment, ainsi, d’après le texte
organique signé par le roi Roger II en mai 1131: il est créé «a la pointe du
phare» de Messine un grand monastère destiné à être la maison-mère de tous les
monastères grecs qui sont soumis à sa juridiction, soit une quarantaine environ,
divisés en monastères mineurs qui seront administrés par des économes envoyés
par le Saint-Sauveur de Messine, et en monastères indépendants administrés par
des higoumènes, choisis par leur communauté, avec approbation de l’archimandrite
du Saint-Sauveur; car tel était le nom du chef de cette « congrégation » du
genre bénédictin. L’archimandrite, élu par les moines du Saint-Sauveur, fait
ratifier son élection par le roi, avant de recevoir la bénédiction: il ne dépend
d’aucune autorité ecclésiastique,
1.
Gertrude Robinson, History and Cartulary of the Greek Monastery of S. Elias
and St. Anastasius of Carbone. I. History (Orientalia Christiana,
XI, 5), Rome, 1928, p. 285-302.
2.
Gertrude Robinson, op. cit., p. 298-299.

96
ne
relève que du roi, mais verse un cens à l’évêque de Messine [1]. On a reconnu
l’exemple type de la grande seigneurie monastique médiévale d’Occident.
L’archimandrite de Saint-Sauveur de Messine est, en effet, un des plus grands
feudataires de Sicile, ses biens domaniaux sont exemptés de charges
seigneuriales, ses biens allodiaux (donations, biens personnels des moines,
biens achetés à des prix dérisoires) sont considérables; tous ne peuvent que
s’accroître puisque la propriété monastique est inaliénable [2]. Et il semble
bien que l’agent grec des grandes créations centrales normandes ait été,
directement ou indirectement, le fondateur de S. Marie du Patir de Rossano, s.
Barthélémy et il s’est inspiré, il le dit textuellement, des constitutions
monastiques (τυπικά en grec) du Stoudiou, du Mont-Athos et de S. Sabas de
Jérusalem.
L’histoire du temporel de S. Marie du Patir de Rossano et de S. Jean Théristès
de Stilo, qui pourra être écrite, celle de S. Nicolas de Casole, qui ne pourra
être qu’esquissée, faute de sources, étendra la description de ces nouvelles
puissances économiques féodales; chacune mérite une monographie; elles sont nées
de la volonté de ne pas laisser périr des institutions grecques byzantines alors
en décadence économique, (comme le reste des autres classes paysannes en Italie
sans doute, dans la deuxième moitié du XIe siècle) [3], mais aussi de
la volonté de les inclure dans un cadre institutionnel, d’où les excluait leur
nature première; substitution d’un lien juridique autoritaire à des liens
simplement spirituels, qui rattachaient chacune des skites d’Italie au
patriarche de Constantinople et à l’Empereur, par le lien de l’εὐταξία, qui est
le bon ordre de la société humaine dans l’ordre de la Création.
1.
Editions: 1) S. Cusa, I diplomi greci ed arabi di Sicilia, 1, 1, Palerme,
1868, p. 292-294 (d’après une copie faite par Antonino Amico au XVIIe
siècle); 2) G. Spata, Diplomi greci inediti, Miscellanea di storia italiana,
9, 1870, p. 94-101 (d’après la même copie); une autre copie du XVIIe
siècle est conservée à Rome, Bibl. vat., Cod. Vat. Lat., n° 8201, fol. 128-129.
L’acte est relevé par E. Caspar, Roger II (1101-1154) und die Gründung der
normannisch-sicilianischen Monarchie, Innsbruck, 1904, p. 507, n° 69; voir
une analyse du document dans M. Scaduto, Il monachismo basiliano ...,
Rome, 1947, p. 75-77.
2.
La description touffue, mais convaincante de cette puissance est à lire dans le
volume de M. Scaduto, Il monachismo basiliano . . ., Rome, 1947, p.
217-265.
3.
M. Scaduto, Il monachismo basiliano..., Rome, 1947, p. 185.

97
C’est le rôle des monastères grecs d’Italie du Sud et de Sicile dans l’histoire
économique du Moyen Age que je me suis efforcé d’examiner et d’expliquer jusqu’à
présent; si cette base peut être considérée comme suffisamment ferme, pénétrons
à l’intérieur de ces couvents et immisçons nous quelque peu dans leur intimité.
B) Βίος θεωρητικός, ou société monastique et spiritualité
grecques en Italie du Sud et en Sicile.
Avant d’essayer de comprendre les cadres spirituels de la vie monastique
grecque, il me paraît nécessaire, en introduction, de faire connaissance avec
les hommes et de les placer dans le cadre matériel de leur vie journalière.
1) Introduction
a) Images de couvents.
Suivons Christophe et son fils, Macaire, cheminant en Calabre à la recherche
d’une retraite, au milieu du Xe siècle; ils arrivent au Merkourion,
région montagneuse couverte de forêts et peuplée de moines disséminés ça et là:
«Certains mènent la vie absolument érémitique», écrit l’hagiographe, «et passent
toute leur vie sans autre interlocuteur que Dieu, d’autres habitent dans une
quantité de laures, où ils pratiquent l’ἡσυχία, d’autres, enfin, suivant une
règle mixte, acceptent le combat pour l’obéissance» [1]. Ce sont là, décrits en
un langage un peu fruste, les trois modes de vie des moines grecs du Merkourion
comme des autres centres monastiques du monde byzantin: l’ermitage
inaccessible, le monastère composé d’un certain nombre de petites demeures
séparées voisines de l’église conventuelle, et, enfin, la demeure à l’écart
du moine qui a reçu de son higoumène l’autorisation de s’isoler pour un temps
plus ou moins long. A ces trois modes de vie correspondent trois formes de
résidences monastiques, dont il reste un assez grand nombre de vestiges
1.
Vie de s. Sabas, éd. J. Cozza-Luzi, Historta et laudes. . . Rome, 1893, §
7, p. 14:
Ἔνθα ὅτι πλεῖστοι κατῴκουν μοναχοὶ πόνοις ἀσκήσεως εὐτόνως ἐγγυμναζόμενοι· οἱ
μὲν τὸν ἐρημικὸν πάντη καὶ ἄμικτον μετερχόμενοι βίον καὶ τῷ Θεῷ προσλαλοῦντες
μόνῳ, οἱ δὲ οἰκίσκοις ἡσυχίαν ἱκανοῖς παρέχειν ἐγκαταμείνοντες, ἕτεροι δὲ μιγάδι
στοιχοῦντες κανόνι καὶ τὸν τῆς ὑποταγῆς ἆθλον ἀνύοντες.

98
incomplètement inventoriés dans tout le sud de l’Italie et en Sicile
[1]. J’ai
employé le terme imprécis de «résidences», car, jusqu’à l’époque normande où les
nouveaux centres furent pourvus de bâtiments importants, la diversité et la
rusticité des établissements, allant de la grotte humblement aménagée aux
constructions élaborées, et, pour parler en termes économiques, du gîte pastoral
le plus élémentaire à l’exploitation rurale, sont l’image la plus vraisemblable,
dans l’état actuel de nos connaissances. Il faudrait distinguer encore, bien
sûr, entre les installations urbaines et les centres ruraux, puis déterminer les
rapports, s’il y en eut, entre les deux: c’est ainsi que les monastères ruraux
aidaient le monastère constantinopolitain du Stoudiou [2].
Mais je voudrais insister encore sur cette image descriptive des installations
monastiques et ajouter, à l’intention de ceux qui s’occupent de l’histoire du
monachisme occidental, que les trois formes citées du monachisme oriental
cohabitent et ne sont pas, comme on l’a cru quelquefois, trois stades d’une
évolution [3]; le moine d’un monastère cénobitique peut quitter le couvent et
mener, non loin, la vie retirée de l’ascète pour rentrer ensuite dans le cadre
cénobitique; celui qui, comme Sabas ou Macaire, gagne un centre monastique, peut
se fixer dans une grotte ou une caverne, celle-ci sera, en général, située à
proximité d’un monastère [4], dont l’anachorète dépendra plus ou moins.
1.
Les professeurs Adriano Prandi, Agostino Pertusi et moi-même avons obtenu que
les savants réunis à Passo della Mendola (Trento) au mois de septembre 1962,
pour traiter de «L’eremitismo in Occidente nei secoli XI e XII», émettent le vœu
que soit institué à l’Université de Bari un centre international (dit «Centro
per lo studio delle sedi eremitiche e cenobitiche d’Italia») qui serait chargé
de centraliser la documentation bibliographique et monumentale dispersée en
Italie du Sud et en Sicile, en vue de la rédaction d’une carte archéologique et
de la publication des monuments. On peut espérer la réalisation de ce projet.
2.
J. Leroy, La réforme studite, dans Il monachesimo orientale (Orientalia
Christiana Analecta, 153), Rome, 1958, p. 206.
3.
K. Lake, The Greek Monasteries in South Italy, The Journal of
Theological Studies, 4, 1903, p. 364, imagine à tort, je crois, une
évolution chronologique de chaque institution depuis l’ermitage jusqu’à la laure
et au monastère; le texte cité ci-dessus (p. 97, n. 1) prouve le contraire. Une
étude sémantique à faire des termes employés pour désigner les établissements
monastiques écarterait aussi l’interprétation du savant anglais.
4.
Dans le Merkourion, Nil remarque une grotte, qui était située à peu de distance
des monastères, σπήλαιον δέ ἐστιν οὐ μακρὰν τῶν μοναστηρίων (Vie de s. Nil, Acta SS., Sept., VII, § 13, p. 270).

99
Cet échange perpétuel entre la vie cénobitique et la vie érémitique, sans qu’il
y ait, comme on le verra ensuite, à opposer les deux modes de vie, explique
l’aspect hétéroclite et désordonné des sites monastiques grecs et l’originalité
de ces groupements: la naissance de ces centres serait à chercher et dans des
lieux de culte païens ou chrétiens (païens, puis chrétiens) antérieurs et dans
des ermitages plus ou moins légendaires, celui de s. Luc pour le Latinianon,
celui de s. Sabas pour le Merkourion, celui de s. Elias dans Les Salines et tant
d’autres.
Le
microcosme monastique formé d’un couvent organisé contrôlant et
protégeant un certain nombre de skites et d’ermitages isolés a pu s’élargir en
Italie, comme dans le reste du monde byzantin, en une véritable «confédération»
de monastères placée sous l’autorité du centre le plus puissant. Je prends un
exemple en Asie mineure, pour écarter certaines interprétations qui voulaient
voir dans les associations de monastères grecs en Italie une création latine;
celui de S. Paul sur le mont Latros (Besh-parmak) près de Palatia (l’ancienne
Milet) en Asie Mineure: en septembre 1222, le patriarche Manuel Ier lui restitue
l’archimandritat qui était passé au monastère τῶν Κελλιβάρων; l’higoumène de S.
Paul est responsable désormais de la discipline dans les dix monastères
patriarcaux fixés sur les flancs de la montagne [1]. Je citerai encore le monastère
du Stoudiou à Constantinople qui contrôlait le Sakkoudion sur le mont Olympe en
Bythinie, S. Christophore, Les Tripoliens, le monastère des Katharoi, etc.
[2] à
l’époque de Théodore, celui de S. Anastasios de Carbone, les groupes du
Merkourion, du Latinianon et d’autres en Calabre et en Lucanie, plus tard le
Mont-Athos en Grèce [3].
1.
F. Miklosich – J. Müller, Acta et diplomata graeca medii aevi sacra et
profana, IV, Acta et diplomata monasteriorum et ecclesiarum Orientis,
Vienne, 1871, p. 296:
Τῷ
ἐπισκέπτεσθαι τὰ πρὸς ὄνομα διαληφθησόμενα ἐνταυθοῖ μοναστήρια τὰ καὶ ὀφείλοντα
εἶναι ὑπὸ τὴν αὐτοῦ διεξαγωγὴν καὶ κυβέρνησιν, ἤγουν . . . τὰ χρῄζοντα
διορθώσεως διορθώσεται καὶ τὸ χωλεῦον ἰάσεται καὶ τὸ πλανώμενον ἐπιστρέψει . . .
On
doit penser que la naissance de ces confédérations était nécessitée par l’état
de décadence de certains monastères.
2.
J. Leroy, La réforme studite, dans Il monachesimo orientale (Orientalia
Christiana Analecta, 153), Rome, 1958, p. 205-206: c’est l’higoumène du
Stoudiou qui nomme aux higoumènats et aux diaconies.
3.
Voir, par exemple, L. Bréhier, Les institutions de l’Empire byzantin (L’évolution
de l’humanité, 32 bis, Le Monde byzantin, II), Paris, 1949, p.
560-561.

100
Tous ceux-ci pendant la période byzantine. La création de l’archimandritat de
Messine et des autres grands centres italiens (Casole, Carbone, Stilo, Rossano)
par le pouvoir normand avait donc une solide tradition dans l’histoire
monastique byzantine depuis l’archimandrite du Mont-Olympe [1] et les réformes
disciplinaires du grand higoumène du Stoudiou [2]. L’innovation apportée par
l’unification normande est qu’elle a été voulue et faite autour
d’institutions (appuyées, certes, par des implantations grecques antérieures
substantielles), tandis que les groupements byzantins se sont effectués
progressivement autour de grands noms de religieux et de réformateurs et de
leurs monastères. L’esprit est différent, l’aboutissement est le même: ce sont
des puissances économiques et religieuses qui «protègent», comme l’on disait au
siècle dernier, des groupes économiques plus faibles.
Mais l’aspect de ces couvents reste inachevé, si nous ne munissons pas ceux-ci
des moyens de défense exigés par la situation d’insécurité dans laquelle ils
sont nés: certains, je l’ai dit plus haut, sont proprement fortifiés, d’autres
ont choisi de s’établir près d’ouvrages militaires tenus par la troupe, les
moins nombreux sont exposés aux raids des pirates de toutes origines et devront
se rapprocher, en cas de danger, de sites moins ouverts.
Passons la porte de l’une de ces pieuses demeures, pour apercevoir quelques uns
de leurs habitants.
b)
Portraits de moines.
Les moines, dont on peut connaître un peu de la physionomie, sont connus par les
Vies de Saints. L’hagiographie grecque d’Italie du Sud et de Sicile inspire
quelque confiance, car les auteurs sont tous à peu près contemporains des héros
dont ils décrivent les exploits. Il n’en reste pas moins qu’ils obéissent à la
loi du genre, qui est de plaire au lecteur médiéval en l’édifiant; il reste
aussi que la vérité me paraît avoir eu un autre sens en grec et en latin. Ceci
dit, regardons.
Voici, d’abord, un grand moine international, Elie de Enna (fin du IXe
siècle); né en Sicile de parents illustres, il fait de très bonnes études, puis,
après avoir été déporté par les Arabes en Afrique,
1.
Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Ὀλύμπου ὄρους, cité par J. Pargoire, dans Dict. Archéol.
Chrét. Lit., art. Archimandrite, Paris, 1907, col. 2750.
2.
J. Leroy, La réforme studite, dans Il monachesimo orientale (Orientalia
Christiana Analecta, 153), Rome, 1958, p. 192-195.

101
il
visite les grands sanctuaires et les monastères fameux de Palestine et d’Egypte
(Alexandrie, Sinaï), il va jusqu’en Perse, revient en Afrique, rentre en Sicile,
mais pour peu de temps, avant une nouvelle course dans le Péloponnèse, l’Epire,
Corfou, Rome, pour se retirer enfin dans Les Salines, au nord-est de Reggio où
il fonde l’un des plus célèbres monastères de la Calabre byzantine. Il mourra à
Thessalonique, en route vers Constantinople, où l’appelait l’empereur Léon VI
[1]. Voici un spélaiôtès, un moine qui vit dans une caverne (début du Xe
siècle): il est né dans une famille riche de Reggio, où il a étudié longuement
les Ecritures, s’est retiré ensuite sur une colline de Sicile, puis a rejoint un
monastère voisin de Reggio avant de s’installer dans une tour près de Patras où
il vivra huit ans avec son disciple Arsénios, fuyant l’avance arabe, pour
revenir ensuite à son monastère de S. Eustratios près de Reggio, puis aux
Salines, et se retirer, enfin, dans une caverne à Melicuccà (25 km. N.-E.
Reggio) que l’affluence de ses admirateurs le contraindra à transformer en
centre monastique [2]. Voici un ascète érudit: s. Vital de Sicile (milieu de Xe
siècle); né, lui aussi, dans une famille riche de Sicile, il étudie avec les
plus grands savants (de Sicile?) et devient à son tour très expert dans les
lettres sacrées; moine dans le célèbre monastère S. Philippe d’Agira, il vivra
quinze ans la vie conventuelle, mais se retirera ensuite près de Santa Severina
en Calabre dans des thermes en ruines, reviendra en Sicile vivre sur une colline
près de son ancien monastère, reprendra la route de Calabre où il vivra dans une
grotte près d’Armento, puis fondera deux monastères [3]. Voici le type du grand
fondateur: Nil de Calabre (910-1005), né d’une famille illustre de Rossano, il
reçoit une éducation soignée et s’intéresse surtout aux vies des Pères, il se
retire dans un monastère du Merkourion, puis au monastère S. Nazaire,
probablement près du mont Bulgheria, il gagne ensuite Rome pour prier sur le
tombeau des Apôtres et chercher des manuscrits, rentre au Merkourion, puis fonde
l’important monastère de S. Hadrien au nord-ouest de sa ville natale, puis celui
de S. Anastasie à Rossano même; à 60 ans, il gagne la Campanie où il fonde le
monastère S. Michel sur le domaine de Valleluce, qui lui a été cédé par l’abbé
bénédictin du Mont-Cassin;
1.
Vie de s. Elias de Enna, éd. G. Rossi Taibbi, Vita di sant’Elia...,
Palerme, 1962, p. 2-123.
2.
Vie de s. Elias le Spélaiôtès, Acta SS., Sept., III, p. 848-887.
3.
Vie de s. Vital de Sicile, Acta SS., Mart., II, p. 26-35.

102
à
85 ans, il va fonder un autre monastère près de Gaete à Serperi et enfin près de
Tusculum, celui de S. Agathe [1].

S.
Nil de Rossano
(Abbaye de Grottaferrata. Musée. Panneau d’un diptyque de bois de l’Ecole
florentine du XIIIe s.).
Telles sont les figures les plus hautes en couleurs; il en est de moins
éclatantes, celle de Léon de Corleone,
1.
Vie de s. Nil, Acta SS., Sept., VII, p. 282-342.

103
un
pâtre qui deviendra higoumène au mont Mula près de Cassano [1], celle de Sabas
le Jeune, né d’une famille distinguée des environs de Troina en Sicile, qui
vivra au Merkourion [2], comme Christophe et Macaire
[3], celle de Luc de Demenna, riche et savant, qui vivra au monastère S. Julien près d’Armento
[4].
Tous ou presque sont de famille aisée, ont fait des études sérieuses, entendons
qu’ils ont pris en tout cas une solide formation scripturaire près d’un
monastère ou à défaut d’un vieux moine; mais Nil de Calabre est aussi un
brillant commentateur des textes sacrés [5]. Et notons au passage que les grands
monastères voisins des villes étaient des foyers de culture intellectuelle
importants [6]. Tout retirés du monde qu’ils sont, ces moines sont sollicités
par les plus hauts fonctionnaires ou les notables influents sur la conduite à
suivre dans telle ou telle circonstance délicate, ils interviennent aussi pour
défendre les faibles ou les opprimés contre les entreprises du pouvoir: Elie de
Enna conseille le commandant de la flotte byzantine [7], Elie le Spélaiôtès
descend de sa tour pour venir parler aux notables de Fatras qui l’invitent à
déjeuner en leur compagnie [8], Nil sauve les habitants de Rossano de la
vindicte du représentant local de l’empereur, par une démarche personnelle
[9].
Ces moines sont les grands fondateurs, les thaumaturges, dont le souvenir, un
peu embelli, est nécessaire à toute histoire monastique. Les hagiographes, dans
un raisonnable souci de merveilleux, ont tu l’existence des très nombreux
disciples de ces grands chefs; et de ceux-là l’histoire ne peut qu’imaginer le
visage mais ne doit pas oublier le rôle économique et social essentiel. Il
semble qu’à cette époque héroïque d’énergie ait succédé une période de décadence
qui se concrétiserait dans la figure de s. Philarétos:
1.
Vie de s. Léon-Luc de Corleone, Acta SS., Mart., I, p. 98-102.
2.
Vie de s. Sabas, éd. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes . . ., Rome, 1893,
p. 5-70.
3.
Vie des saints Christophe et Macaire, éd. J. Cozza-Luzi, Historia et laudes
. . ., Rome, 1893, p. 71-96.
4.
Vie de s. Luc de Demenna, Acta SS., Oct., VI, p. 337-341.
5.
Vie de s. Nil, Acta SS., Oct., VI, p. 289-291.
6.
Le sujet reste à traiter; il y a eu plusieurs enquêtes particulières. Il faudra
les poursuivre dans deux directions: scriptoria et bibliothèques
monastiques. On peut lire à titre d’exemple, celle qui a été conduite par R.
Devreesse, Les manuscrits grecs de l’Italie méridionale (Histoire,
classement, paléographie) (Studi e testi, 183), Cité du Vatican,
1955, in-8°.
7.
Vie de s. Elias de Enna, éd. G. Rossi Taibbi, Vita di sant’Elia . . .,
Palerme, 1962, p. 74-76.
8.
Vie de s. Elias le Spélaiôtès, Acta SS., Sept., III, p. 857.
9.
Vie de s. Nil, Acta SS., Sept., VII, § 61-62, p. 296-297.

104
pâtre, devenu jardinier aux Salines, pendant l’époque normande, c’est un ascète
d’une rare résistance physique, mais d’une inculture égale [1]. Est-ce un type
lui aussi? Je le crois.
La
scène et les acteurs nous sont désormais sensibles. Nous pouvons nous risquer à
comprendre «le combat pour le salut» qui se livre devant nos yeux. Il ne peut
être question de l’observer dans toute sa vivante et, parfois, «dramatique»
diversité. C’est encore à l’essentiel que je tendrai ici, en essayant de saisir
et d’expliquer l’idéal spirituel de cette société monastique.
2)
L’idéal du moine grec: cénobitisme et hésychasme
a) «Κοινωνία γὰρ βίος τελεωτάτη . . ., κοινὰ δὲ τὰ σύμπαντα . . .
[2]. La vie cénobitique est la vie parfaite, celle où tous les biens sont en
commun ... », affirme s. Basile qui résume ici son sentiment et celui des Pères
de l’Eglise; le docteur de Césarée, qui réussit à assurer la stabilité de la
société monastique en établissant les vœux perpétuels et a voulu lui laisser,
non une règle, mais une doctrine de vie, a préféré la vie du cénobite à celle de
l’anachorète. Ses disciples, qui édicteront des règles d’application à partir
des principes qu’il avait exprimés, et qui avaient été nuancés ou amplifiés par
les décrets des conciles, les ordonnances des patriarches et les commentaires,
souligneront encore cette tendance. Théodore de Stoudiou, conscient des
désordres nés des persécutions iconoclastes, qui avaient pratiquement abouti à
la disparition des monastères cénobitique traditionnels, remplacés par des
assemblages plus ou moins cohérents d’anachorètes, ou des créations improvisées,
renoue avec l’enseignement de s. Basile, en insistant sur la nécessité de la vie
en commun [3].
1.
K. Lake, The Greek Monasteries in South Italy, The Journal of
Theological Studies, 5, 1904, p. 22.
2.
Ἀσκητικαὶ διατάξεις, Migne, P.G., t. 31, col. 1382; une très belle
apologie du cénobitisme est développée par l’auteur jusqu’à la colonne 1388.
3.
C’est tout l’esprit de l’œuvre de Théodore du Stoudiou; lire, par exemple, la
Grande Catéchèse, éd. J. Cozza-Luzi, Novae Patrum bibliothecae ... tomi noni
pars II, Rome, 1888, p. 36, ou 44:
Ἀλλ’ οὖν γινώσκετε, ἀγαπητοί μου καὶ περιπόθητοι, ὅτι αὐτὸς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς
Χριστός, ὁ διανομεὺς τῶν ἀπερινοήτων ἀγαθῶν, κατελθὼν ἐπὶ τῆς γῆς οὐκ ἐρημικὸν
ἠσπάσατο βίον, οὐδὲ στυλιτικόν, οὐδὲ ἐξ ὧν εἰρήκαμεν ἄλλον, τὸν δὲ δι’ ὑποταγῆς
ὅρον καὶ κανόνα ...
Je
me réfère à la Grande Catéchèse, car c’est celle qui, de l’avis de tous, eut le
plus d’influence sur les monastères grecs de l’Italie du Sud; lire J. Leroy, La réforme studite, dans
Il monachesimo orientale (Orientalia
Christiana Analecta, 153), Rome, 1958, p. 213; T. Minisci, Riflessi
studitani nel monachesimo italo-greco, dans Il monachesimo orientale (Orientalia Christiana Analecta, 153), Rome, 1958, p. 224.

105
L’obéissance à l’higoumène, la pauvreté qui est absence de propriété, mais aussi
pauvreté du vêtement et de la nourriture, la chasteté, qui est virginité et
fuite devant la femme et le jeune homme, tel est le cadre général imposé par s.
Basile et précisé par Théodore du Stoudiou [1], qui insiste en outre, après ses
maîtres, sur l’obligation de demeurer dans le même monastère, car l’union du
moine et de son couvent est aussi indissoluble que le lien du mariage
[2], sur
l’obligation de la prière en commun depuis l’aube jusqu’à la nuit suivante
[3],
enfin sur la nécessité du travail manuel [4]. Théodore du Stoudiou, comme Basile
de Césarée, assortiront ces consignes de peines plus ou moins chiffrées, mais
qui excluent toujours les peines corporelles et, en particulier, la fustigation
[5]; le fait est à noter.
Tels sont les préceptes, pris dans les Catéchèses, le Pénitentiel ou
l’Hypotypôsis du Stoudiou, qui servirent de base à la rédaction des typika des
monastères d’Italie:
1.
S. Basile, P.G., t. 31, col. 1424: Ὅτι οὐ χρὴ τὸν ἐν συστήματι
πολιτευόμενον ἀσκητὴν ἰδίᾳ τι κεκτῆσθαι τῶν ὑλικῶν. Voir aussi col. 637,
1344-1345, 1361. Théodore du Stoudiou, Petite Catéchèse, éd. E. Auvray, Theodori Studitis praepositi, Parva Catechesis, Paris, 1891, p. 176, 227,
267, 338, 357 et P.G., t. 99, col. 940 (Lettre à son disciple Nicolas,
qui vient d’être élu higoumène): Οὐ κτήσῃ τι τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ
ἀποθησαυρίσεις ἰδιορίστως εἰς ἑαυτὸν μέχρι καὶ ἑνὸς ἀργυρίου, col. 944 Οὐ
θησαυρίσεις χρυσίον ἐν τῇ μονή σου, col. 1556, etc.
2.
S. Basile, P.G., t. 31, col. 1395; Théodore du Stoudiou, P.G., t.
99, col. 1596: Εἰ γὰρ ἐκεῖ (= dans le mariage) καίτοι σαρκικῇ ζεύξει ἀπηγόρευται
ὁ χωρισμός, πόσῳ γε μᾶλλον ἐπὶ πνευματικῇ συναφείᾳ.
3.
S. Basile, P.G., t. 31, col. 1325.
4.
Μετὰ ταῦτα (= chant de l’office) εὐχόμενοι τῷ θεῷ κατευθυνθῆναι ὑμῶν τὸ ἔργον
τῶν χειρῶν καὶ ὁλοτελῆ τὴν ἡμέραν ἀγαθοεργῶς ἐκπληρωθῆναι. Προσιτέ τοῖς ἔργοις
ἄλλος ἀλλαχοῦ ἢ καὶ ὁμοθυμαδὸν ὠς ὑποπίπτουσιν αἱ χρεῖαι, ἀπαρτιζόμενοι κἀκεῖ
μετὰ τῆς στιχολογίας ἡ ἀργασία, μετὰ τῆς εὐχῆς καὶ καλονοίας, ἥτε ἀροτρίασις
ἔστω ἥτε ἀμεπελουργία, ἥτε ἀψοποΐα, εἴτε ἄλλό τι τῶν ἐνεργουμένων . . . (Grande
Catéchèse, éd. J. Cozza-Luzzi, p. 48).
5.
S. Basile, Ἐπιτίμια, P.G., t. 31, col. 1305-1316; Théodore du Stoudiou,
Ἐπιτίμια, P.G., t. 99, col. 1733-1757, et Grande Catéchèse, éd. J.
Cozza-Luzi, p. 79: Γινωσκέτω ἕκαστος τὴν ἰδίαν τάξιν . . ἀλλὰ ταῦτα ( =
confusion) μὴ γενηθήτωσαν, ἵνα μὴ ἔλθωσι βαρέα ἐπιτίμια ἐπὶ τοὺς τὰ τοιαυτα
πράσσοντας.

106
l’higoumène est responsable de la morale et de la discipline, il ne peut
accueillir un moine d’un autre monastère, la vie commune exige limitation dans
le vêtement et la nourriture, repas en commun dans le silence avec lecture
édifiante, l’higoumène est seul à pouvoir absoudre certaines fautes et à
certaines périodes de l’année, il veillera à l’entretien des lampes qui doivent
brûler jour et nuit devant les reliques et les icônes saintes et à
l’accroissement de la bibliothèque de son monastère, etc. Ce sont les
principales règles d’un typikon d’Italie, celui de S. Sauveur de Messine
[1];
les autres étaient semblables.
Ces textes sont l’œuvre de réformateurs. L’histoire sait ce que valent ces
réformes, lois édictées souvent contre des tendances irréversibles.
S.
Nil de Calabre, fondateur et chef attentif de monastères fameux, retourne à sa
grotte, pour retrouver la solitude et l’ἡσυχία «qu’il chérit comme une mère»
[2]. Nous touchons ici au problème spirituel le plus intime de la société
monastique grecque.
b) Ἐρημία καὶ ἡσυχία: solitude et paix contemplatives.
L’ascension spirituelle de celui qui a choisi la vie monastique est une
progressive conversion du cœur qui s’éloigne des choses extérieures, où
vagabonde l’esprit, pour atteindre les choses intérieures. C’est l’enseignement
des Néoplatoniciens puis du Pseudo-Denys l’Aréopagite, de s. Basile, de ceux que
l’on appelle les «Pères mystiques» et enfin des Hésychastes. La prière intime
(νοερὰ προσευχή) des moines de l’Athos au XIVe siècle est
l’expression la plus frappante de cette discipline [3]. Cette conversion du cœur
des phénomènes extérieurs vers le moi intérieur, présuppose silence, calme
(ἡσυχία) et absence de soucis (ἀμεριμνία).
Ce
combat solitaire contre la nature est nécessaire, si l’homme veut atteindre
Dieu et faire son salut, but de la vie monastique. L’homme qui vit sur la
terre est, en effet, comme exilé de sa patrie naturelle, qui est le séjour de
Dieu [4].
1.
M. Scaduto, Il monachismo basiliano ..., Rome, 1947, p. 196-213.
2.
Ἀνέρχεται πάλιν ἐν τῷ
σπηλαίῳ, τῆς συνήθους
ἐχόμενος πολιτείας, καὶ τὴν
ἡσυχίαν
ἀσπαζόμενος
ὡς οἰκείαν μητέρα . . . οὐ
γὰρ εὕρισκεν ἐν αὐτοῖς
ὃ
ἐπιζήτει
ἐρημίαν
καὶ ἡσυχίαν καὶ πολλῶν
ἀποικίαν (Acta SS., Sept., VII, § 22, p. 276; voir aussi
le § 86, p. 311).
3.
Théoklètos de Dionysiou, Μεταξὺ
οὐρανοῦ
καὶ γῆς.
Ἁγιορειτικὸς μοναχισμός,
Athènes, 1956, p. 73.
4.
Ibidem, p. 67.

107
Le
moine s’élèvera donc peu à peu au-dessus de cette terre pour se rapprocher du
ciel: ἐξώκοσμος, extrait du monde, il maintiendra son existence en suspens
«entre ciel et terre», comme le veut le titre d’un volume récemment paru sur la
spiritualité orientale, écrit par un moine orthodoxe [1].
Ce
but spirituel a-t-il un support philosophique? On le nie, car les systèmes
philosophiques, nés de la contrainte d’expliquer les phénomènes, ne sont que
germes de désordre et de trouble pour l’âme. Le moine, au lieu de chercher à
expliquer le mystère du monde et son cheminement vers le salut, doit repaître
son âme de mystère, car l’âme est naturellement mystique
[2].
Point essentiel, et l’on peut dire que le moine oriental cultive ce mysticisme à
tout prix, de ses formes les plus hautes aux manifestations les plus enfantines.
Ce mystère est son climat de vie, la spiritualité qui mène à la sainteté est, en
effet, sentiment de l’âme et non réflexion de l’esprit. Autre point important,
car les théologiens et les savants, outre qu’ils sont souvent « bouffis par leur
science », suivent une voie qui ne conduit pas à Dieu. Les moines se défient
donc des sciences; certains peuvent renoncer quelque temps à l’ἡσυχία salvatrice
sous une pression extérieure et s’intéresser aux dernières découvertes faites en
théologie ou en histoire de l’Eglise, mais, pour la plupart, il ne reste «ni
problèmes, ni lacunes, car ils savent que leur croyance est juste et que leur
silence est de sagesse. . .»; ce sont les paroles de l’un d’entre eux
[3].
La
pensée scientifique reste en deçà de la spiritualité, elle est donc
superflue, sauf, car il faut un cadre mental à l’ascèse pour Dieu, l’étude des
Pères de l’Eglise, et encore pas de tous: il suffira de lire les principes
d’ascétisme donnés par s. Basile, s. Jean Chrysostome, s. Denys l’Aréopagite
(toujours très écouté), Diadoque de Photicée, Maxime le Confesseur
[4]. Pour la
plupart de nos moines grecs du Moyen Age cette lecture a tenu lieu de culture.
Et cela paraît juste si la vie du moine est Foi (dans le mystère nécessaire à
l’ascèse) et Amour (de son salut). On ne peut que rester pétrifié devant cette
forteresse ou saisi d’étonnement.
La
conversation intérieure avec Dieu étant l’exercice perpétuel du moine à l’Eglise
ou dans sa cellule,
1.
Ibidem, p. 28.
2.
Ibidem, p. 72.
3.
. . . δὲν ὑπάρχουν προβλήματα καὶ ἀπορίαι, διότι γνωρίζουν νὰ πιστεύουν ὀρθῶς
καὶ νὰ σιωποῦν ἐν σοφίᾳ . . . (Ibidem, p. 11).
4.
Ibidem, p. 7 et passim.

108
on
comprend que les maîtres du monachisme oriental aient eu un certain mal à faire
admettre le travail manuel comme une démarche de l’ascèse monastique.

S.
Barthélémy de Rossano
(Abbaye de Grottaferrata. Musée. Panneau d’un diptyque de bois de l’Ecole
florentine du XIIIe s.).
Elie de Enna, au milieu du IXe siècle, dans son monastère des
Salines, passe tout le jour et toute la nuit en prières, car le vrai travail,
pensait-il, est celui qui consiste à prendre soin de son âme, les exigences du
corps étant des besoins accessoires [1].

109
C’est un trait qui sépare la spiritualité orientale et la spiritualité
occidentale: la spiritualité orthodoxe a toujours estimé que sa sœur latine
attachait une valeur démesurée au travail. N’est-ce- pas une conséquence normale
de la valeur éminente de la Crucifixion du Christ, élevée en exemple par les
pères du monachisme occidental, François d’Assise, Joachim de Flore, Ignace de
Loyola, Bernard de Clairvaux, Jean de la Croix? La spiritualité orthodoxe ne
s’attarde pas sur le fait de la souffrance régénératrice (le monachisme oriental
ignore la pénitence corporelle puisque le corps n’a pas de valeur), mais tend
toute entière vers la joie de l’Anastasis, la Résurrection
[2].
On
voit mal le rôle que jouent ces ascètes dans la société de leur temps. Car, à
son état de perfection, ce monachisme est asocial: il ignore et veut ignorer
tout contact avec le monde. Mais dans la société essentiellement religieuse du
monde byzantin, ces moines sont le message continuel du royaume des cieux;
classe contemplative de l’Eglise, le moine «prie pour lui-même, pour l’Eglise
toute entière, pour toutes les âmes qui souffrent et peinent, pour celles,
enfin, qui n’ont jamais prié» [3]. Le rôle reconnu des ascètes est là. Et ils
sont ainsi partie intégrante de la société byzantine. Les joues ravinées par les
exercices ascétiques, les yeux creusés par les veilles, le visage blafard marqué
du sceau des jeûnes et des prières continues, tel est l’ermite grec, tels
étaient Nil de Calabre, Barthélémy de Rossano, Luc de Demenna, et tant d’autres,
dans leur singulière grandeur, tels nous les ont livrés fresques et icônes
[4].
On
ne regrettera pas, pour l’histoire sociale et économique du temps, qu’ils
n’aient pas atteint, eux-mêmes et leurs disciples, l’idéal du moine oriental
qu’ils s’étaient fixé: chaque monastère a eu ses ermites, les ermites ont vécu à
l’ombre des monastères; les deux formes extrêmes
1.
Καὶ γὰρ τὸ πλεῖστον τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτός, πολλάκις δὲ καὶ ὅλην τὴν νύκτα
εἰς τὸ τῆς προσευχῆς ἔργον ἀνήλισκεν· ἔργον γὰρ ἧν αὐτῷ τῷ ὄντι ἡ τῆς ψυχῆς
ἐπιμέλεια, αἱ δὲ τοῦ σώματος ἀνάγκαι πάρεργον (éd. G. Rossi Taibbi, Vita di
sant’Elia . . ., Palerme, 1962, § 41, p. 62).
2.
Théoklètos de Dionysiou, op. cit., p. 96. Un exemple très net: le sens
donné au tombeau du Christ, τάφος, ὅθεν ἔλαμψεν ἡ τῆς Ἀναστάσεως χάρις (Vie de
s. Elie le Jeune du Xe siècle, éd. G. Rossi Taibbi, Vita di
sant’Elia. . ., Palerme, 1962, § 18, p. 26).
3.
Ibidem, p. 70.
4.
Voir p. 102, 108.

110
de
la vie monastique ont toujours cohabité dans le monachisme grec, sauvé de la
dispersion par l’unité de sa doctrine et de ses principes de vie.
Conclusion
Je
n’ai pas mis en doute l’origine byzantine du monachisme grec de l’Italie du Sud
et de la Sicile, puisqu’il ne demeure plus, me semble-t-il, d’hésitation sur ce
principe. Historien de la civilisation byzantine, j’ai donc cherché à
individualiser certains aspects du fait monastique grec dans ce pays pour
comprendre quel rôle il y a joué, quelle évolution il a subie, quelle a été sa
place dans l’histoire de la civilisation grecque médiévale, au sens le plus
large (histoire des hommes et de leurs idées); isolé, en effet, pour l’analyse,
le fait monastique grec doit être replacé ensuite dans son cadre, qui est la vie
des populations grecques de l’Italie du Sud et de la Sicile, où il s’insère
étroitement. Et c’est à déterminer la place occupée par les moines grecs au
milieu de ces populations (latine, grecque, arabe) qu’il faut parvenir pour
comprendre l’étrange tableau humain offert par ces régions au Moyen Age; et je
crois pouvoir dès à présent retenir comme hypothèse de recherche que le
monachisme grec, sous son aspect économique, social et culturel, a été l’élément
d’unité et de continuité de la vie grecque en Italie du Sud et en Sicile du VIIe
siècle peut-être, en tout cas du Xe jusqu’au XIIIe siècle.
Stable par son principe, vivant par sa résistance aux influences étrangères (et
il en mourra), et ces deux traits lui donnent aux yeux des profanes son
apparente inertie, si proche des populations rurales dont il est, en général,
issu et qui dépendent matériellement ou spirituellement de lui, le monachisme
grec, ici, comme ailleurs en d’autres époques, a été le levain avant de devenir
le reliquaire des traditions byzantines.
Et
ceci est un trait original de la civilisation grecque médiévale.
André Guillou.